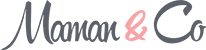Dans le cœur du réel le plus ténébreux, le film «Je ne veux plus y aller maman», réalisé et vécu par Antonio Fischetti, journaliste à Charlie Hebdo, se veut un fascinant périple introspectif. Décryptant avec une étonnante sincérité les traumatismes laissés par l’attentat du 7 janvier 2015, ce documentaire ne se contente pas de rappeler l’événement, mais s’engage plus profondément dans l’écho prolongé de ses répercussions, explorant la complexité des émotions et la quête de thérapie personnelle. Cette œuvre cinématographique personnellement et individuellement filmée, accorde une voix à la douleur souvent tu et ensevelie, mais aussi à l’impression de n’être «ni vraiment vivant ni vraiment mort».

En explorant les tréfonds de l’âme humaine face au traumatisme, le documentaire «Je refuse d’y retourner, maman» d’Antonio Fischetti offre une introspection poignante sur la vie après un acte de terrorisme. Mélangeant souvenirs personnels, enregistrements émotionnels et dialogues thérapeutiques, ce film unique se penche sur les impacts durables des attentats de janvier 2015 sur un individu qui a échappé de justesse à la tragédie qui a ravagé la rédaction de Charlie Hebdo.
Une introspection personnelle au cœur d’un trauma collectif
Antonio Fischetti, journaliste scientifique pour Charlie Hebdo, use de son expertise narrative pour explorer les facettes les plus intimes et les plus sombres de sa survie. Ne se sentant «ni vraiment vivant ni vraiment mort», Antonio choisit la caméra comme outil d’analyse et d’exutoire, creusant dans ses souvenirs les plus enfouis pour confronter et réfléchir aux conséquences de l’attentat qu’il a miraculeusement évité.
La mémoire en héritage
Une partie cruciale du documentaire est dédiée à Elsa Cayat, psychanalyste et chroniqueuse pour Charlie Hebdo, assassinée lors de l’attaque. Fischetti revisite ses sessions enregistrées avec elle, qui continuent de resonner avec une présence poignante. Ces séquences ne sont pas seulement un hommage, mais aussi un moyen pour Antonio de se reconnecter avec un passé troublant et influent, dont les échos affectent indéniablement sa manière de vivre et de percevoir le monde actuel.
Des échos thérapeutiques
Le film apporte également un éclairage sur la relation presque thérapeutique qu’Antonio entretient avec son psy actuel, Yann Diener. Leur interaction offre au documentaire des moments de soulagement, où l’humour et la légèreté semblent percer le voile épais de la tragédie. Ces échanges révèlent les efforts d’un homme pour se libérer de l’entassement des images douloureuses et trouver un chemin vers la guérison. Une scène particulièrement marquante montre comment une simple phrase de Diener ouvre une perspective nouvelle à un Antonio perdu dans les méandres de ses pensées.
Une collecte de fonds communautaire
Le projet de Fischetti a vu le jour grâce à la générosité de 920 donateurs qui ont contribué à sa réalisation par crowdfunding. Ce financement participatif témoigne non seulement de l’intérêt du public pour des témoignages authentiques et personnels sur des événements historiques, mais aussi de la solidarité en réponse aux traumatismes collectifs. Le film, produit par Philippe Bouychou, est un vibrant exemple de la manière dont l’art peut contribuer à la guérison et à la mémoire collective.
Une vision inclassable
Catalogué comme inclassable, ce documentaire réunit non seulement l’histoire d’un homme et son combat personnel contre le spectre du terrorisme, mais il bouscule également les frontières du genre documentaire. Par ses techniques narratives, il se positionne quelque part entre un journal intime filmé et une exploration documentaire, offrant ainsi une perspective unique et profondément humaine sur les incidences long-terme du trauma.
Ce documentaire n’est pas juste une œuvre cinématographique, mais un véritable acte de résilience qui défie les affres du temps et de l’oubli, et propose dans son sillon un chemin de réflexion pour tous ceux touchés, de près ou de loin, par les tragédies similaires.